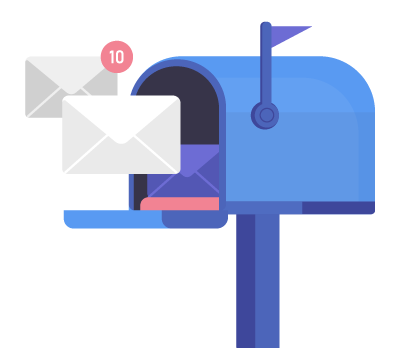Chez PSF, nous croyons profondément à la pluralité et à la richesse des pratiques d’accompagnement. Parce que notre mission consiste à promouvoir une supervision professionnelle ouverte, réflexive et exigeante, il nous semble essentiel de questionner aussi le cadre institutionnel dans lequel évoluent les coachs et les superviseurs.
C’est dans cet esprit que nous proposons ici une réflexion sur les tensions auxquelles font face les fédérations de coachs.

La réflexion proposée ici s’appuie explicitement sur l’analyse approfondie menée par Persson et Rappin (2013) dans leur article : « Il était une fois le coaching… », publié dans la revue *Humanisme et Entreprise* (n° 311). Les auteurs y soulignent la complexité inhérente du rôle des institutions de coaching, tiraillées entre une mission de légitimation et la préservation d’une essentielle pluralité :
le pouvoir acquis par une certaine forme de savoir, principalement technique et existentiel dans le cadre du coaching, n’est effectif qu’à la condition de s’inscrire dans un discours.(…)
Les institutions se trouvent prises entre la nécessité politique de fournir un discours nettement identifié sur le coaching d’une part et l’impossibilité épistémologique de canoniser une définition absolue du coaching d’autre part.
Les fédérations assument la responsabilité de construire une histoire officielle du coaching , normalisante, unitaire, pour valoriser la « profession » et rassurer, guider les acheteurs au sein des organisations…
Une tension croissante
Cette tension décrite en 2013 entre canonisation et pluralité semble se renforcer au fil des années.
Cela est perceptible dans la manière dont les fédérations cherchent à encadrer le métier, notamment à travers des référentiels de compétences et des accréditations professionnelles. Ce cadre normatif répond à une compréhensible demande des organisations clientes, en quête de repères fiables dans un marché où règne une certaine confusion.
” l’adhésion à une fédération contraint à respecter certaines normes pour se trouver en accord avec le discours affiché : supervision, processus de certification, adhésion à une charte de déontologie. »
Cette demande de normes et de certifications traduit autant l’inquiétude sur la compétence réelle des coachs que la nécessité, pour les acheteurs, de justifier en interne leur choix auprès de leurs équipes ou de leur hiérarchie.
Cependant, plus les fédérations tentent d’instaurer un récit homogène et rassurant, plus les pratiques individuelles et les approches spécifiques tendent à s’affirmer pour exister et se différencier. Plus le discours officiel est uniformisé, plus les acteurs ont besoin de marquer leurs différences pour se faire acheter leur prestation.
La normalisation accentue paradoxalement les divergences et la fragmentation.
Ce qui se joue dans les livres peut être regardé comme un combat pour la détention de l’histoire dominante, cette histoire qui deviendra officielle et légitime, et qui, de ce fait, sera en position d’édicter des normes de réflexion et d’action. Or, cette volonté se heurte à des dissidences : autres expériences, autres succès, constats d’échecs, propositions d’alternatives, analyses scientifiques, réflexions philosophiques… Autant d’histoires parallèles écrites « avec », « à côté », « contre », et qui font de l’histoire officielle du coaching (voire même des histoires officielles) un équilibre passager et bien fragile.
Cette normalisation progressive peut aussi être lue comme une internalisation subtile, mais profonde, des logiques managériales modernes, qui contribuent pourtant à générer une partie des problèmes abordés dans les accompagnement de coaching…
Une internalisation du discours managérial
Cette observation invite à questionner la manière dont la pensée rationaliste qui domine largement l’univers managérial occidental tend à influencer les fédérations dans leur volonté d’homogénéiser les pratiques. Pour plaire aux acheteurs, elles adoptent le discours dominant et ses idéaux de standardisation et d’industrialisation.
Les auteurs nous mettent en garde contre cette illusion :
« ll est difficile de croire en un coaching homogène parce que humaniste (porté par des valeurs éternelles), scientifique (evidence based coaching) ou normalisé (sous couvert d’accréditations et de certifications professionnelles). La pluralité des voix et des lieux d’expression nous obligent à renoncer à la naturalité du coaching et à le recontextualiser au sein de l’époque du « nouvel esprit du capitalisme », des mutations du management et dans les si nombreux jeux d’acteurs et d’institutions : l’ambition semble vaine qui voudrait retracer l’histoire objective de l’accompagnement en prenant pour points de départ Lao Tseu, Jésus ou Socrate, comme relais la confession et le conseil aux Princes et comme terme logique de ce processus le coaching. »
Davantage de questionnement post-moderne ?
Persson et Rappin invitent à adopter un point de vue post-moderne :
« l’approche postmoderne valorise la polyphonie et la pluralité ; elle donne la parole à chacun ; elle renonce également à fixer le sens une fois pour toutes »
« Si le management (occidental) est devenu au fil du temps une discipline structurée au service des organisations, c’est parce qu’il vise à faire converger les multiples interprétations des histoires vers une version officielle, en masquant la diversité des points de vue. Mais le but du chercheur critique est de faire ressurgir ces voix étouffées afin de rendre à l’organisation son caractère indéterminé, ouvert sur l’avenir et favorable à la créativité.”
Le coaching se légitimise, non pas dans une homogénéité rassurante, mais dans sa capacité à interroger et remettre en question les récits dominants au sein des organisations. Ce que Pauline Fatien appelle la « malléabilité » du coaching :
« La puissance du discours peut en effet générer une normativité propice à étouffer la malléabilité du coaching qui est pourtant un atout pour les coachés (Fatien, 2008a). »
Assumer la pluralité et l’ouverture ?
La question se pose aux acteurs institutionnels : comment parvenir à offrir des repères clairs tout en protégeant et valorisant la pluralité des approches et des pratiques ?
Ce défi invite à s’écarte des logiques simplificatrices héritées du management moderne, pour adopter une posture réflexive et critique, qui préserve les espaces de questionnement et de diversité indispensables à la vitalité du coaching et des professions de l’accompagnement.
Non pas en choisissant entre homogénéisation et dispersion, mais en assumant pleinement cette tension comme une richesse, une ressource pour des accompagnements vivants, pluriels et évolutifs.
Proposer des espaces de dialogues ouverts, capables d’accueillir, de valoriser et d’articuler les divergences sans chercher à les résoudre ou à les effacer.
Référence :
– Persson, S. & Rappin, B. (2013). « Il était une fois le coaching… ». *Humanisme et Entreprise*, n° 311(1), 41-60.
– FATIEN, P., 2008a, De la malléabilité du coaching face à de nouvelles règles du je(u), Thèse de sciences de gestion, HEC Paris – https://theses.fr/2008EHEC0018
Fidèles à notre engagement chez PSF, nous sommes convaincus que la supervision joue un rôle déterminant dans la préservation de la pluralité. En offrant aux professionnels de l’accompagnement un espace de réflexivité critique et de dialogue constructif, la supervision permet d’accueillir les tensions et les contradictions non comme des obstacles, mais comme des ressources essentielles pour des pratiques vivantes, éthiques et créatives.